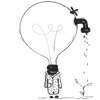Les thérapies psychédéliques et l'initiative PsychedeliCare
Présentation du référendum citoyen, lancé le 14 janvier 2025, visant à démocratiser les thérapies assistées par psychédéliques, répondant à la crise croissante de la santé mentale.
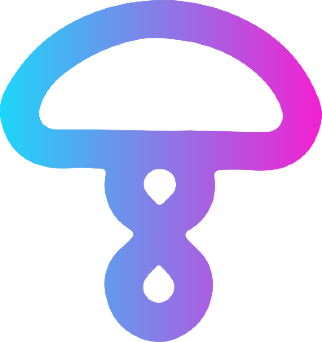
La santé mentale est en crise, vous l’avez sans doute lu ou entendu à gauche et à droite dans les actualités.
En France, c’est une personne sur trois qui sera touchée au cours de sa vie par des troubles de santé mentale ou des problématiques associées. On comprend dès lors que le gouvernement précédent voulait en faire une priorité nationale pour 2025. Pour rappel, la France reste fortement consommatrice d’antidépresseurs et d'anxiolytiques, avec une croissance inquiétante du côté des jeunes depuis 2017.
Au niveau de l'Union européenne, une personne sur six souffre d’un trouble mental actuellement, soit plus de 75 millions de personnes. Ces troubles sont principalement des dépressions, des troubles anxieux, bipolaires et post-traumatiques. La prise en charge de ces patients et la répercussion sur la société à un coût énorme : 600 milliards d’euros par an, c’est l’équivalent d’un quart du PIB de la France, ou le total de celui de la Belgique.
Malheureusement, les traitements psychopharmacologiques actuels sont dans une impasse, car beaucoup de patients ne réagissent pas aux médicaments qui leur sont prescrits et certains traitements ont des effets secondaires très handicapants. Sur le long terme, leur efficacité est également remise en cause et de plus, aucune percée significative au niveau de la recherche pharmacologique n’a permis d’identifier de nouvelle molécule depuis 30 ans.
Trop d’antidépresseurs ou d’anxiolytiques sont encore prescrits par la médecine générale qui n’est pas au fait des traitements psychiatriques mais pense “soulager” la patientèle. À l’inverse, consulter des psychiatres peut rapidement s’avérer une gageure, du non-remboursement par la Sécu ou des délais d’attente à l'hôpital public parfois trop longs (et les psychiatres pas assez nombreux). Au final, nombreuses sont les personnes souffrant d’un trouble de santé mentale qui ne sont pas prises en charge, ou avec un traitement qui n’est pas efficace, ou pire, qui s’avèrera délétère sur le long terme faute d’un suivi adéquat (à cause d’effets secondaires nocifs ou d’une durée de prise trop longue).
La promesse des thérapies assistées par psychédéliques
Dans les années 50, le potentiel thérapeutique des substances psychédéliques, avec en première ligne le LSD et la psilocybine, a été reconnu par des études scientifiques et les résultats observés sur les patients traités, et ce pour un spectre assez large de troubles mentaux : dépression, stress post-traumatique, dépendance à l’alcool et aux opiacés, troubles de l’anxiété, etc.
Fait amusant, la découverte de l’efficacité de ces substances va provoquer à la même époque la découverte du fonctionnement du cerveau et de la psyché, notamment par le biais de la compréhension du rôle des neurotransmetteurs. C’est ensuite en reconnaissant l’action d’autres molécules sur ces mêmes neurotransmetteurs que la psychiatrie décidera de mettre sur le marché antidépresseurs et anxiolytiques. Sans psychédéliques, pas de psychopharmacologie !
La recherche sur les psychédéliques fut ensuite stoppée au début des années 1970 avec leur classification en catégorie I (substances jugées toxiques, addictives et sans intérêt scientifique) dans le cadre de la guerre contre les drogues menée par l'administration Nixon, principalement pour des raisons politiques et en occultant les résultats déjà obtenus. Elle reprit ensuite dans les années 2010 aux États-Unis, où la MDMA est par exemple étudiée pour traiter le stress post-traumatique qui touche de nombreux vétérans des conflits armés. Les travaux de recherche qui luttent contre la dépression, les troubles bipolaires et anxieux, la dépendance à l'alcool et à d'autres substances addictives, qui améliorent le soutien en fin de vie, etc. se sont étendus au Canada, en Angleterre, en Allemagne, en Australie et maintenant en France, aux Pays-Bas, au Portugal... Ils concernent principalement la MDMA, la psilocybine, la DMT, le LSD, la kétamine (une substance associée aux psychédéliques mais ne faisant pas partie des psychédéliques dits classiques).
On parle alors de thérapies assistées par psychédéliques, dans le sens où c’est la thérapie qui soigne, la prise de la substance ne venant agir que comme un déclencheur et un appui permettant au patient de dépasser ses blocages.
La recherche a d’ailleurs fait grand chemin en intégrant totalement la notion de set & setting (l’état d’esprit du patient et son environnement immédiat) dans les séances de prise de la substance en hôpital (mise à disposition d’une salle plus confortable qu’une simple chambre d’hôpital, musique et lumière adéquates, etc.)
L’interdiction des substances psychédéliques dans le monde
Dans le monde en 2025, très peu de pays ont légiféré sur les thérapies assistées par psychédéliques, et la base légale pour une grande majorité de pays reste la Convention sur les substances psychotropes de l’ONU, organisée à Vienne en 1971.
Dans cette convention, les pays s’accordent pour dire que les psychédéliques n’ont pas d’intérêt pour la recherche en plus d’être dangereux pour l’homme, et ce malgré les milliers de patients traités au LSD et à la psilocybine de manière efficace ; les psychédéliques se retrouvent dans la catégorie I.
À l’inverse, toutes les molécules de la psychopharmacologie (dont on découvre à peine les effets pour certaines à l'époque) sont alors rangées dans les catégories inférieures, permettant à la recherche de continuer. Les exceptions à ce coup d’arrêt seront peu nombreuses : d’un côté la Suisse, qui continue à ce jour de permettre à des patients, au cas par cas, d’être autorisés à suivre une thérapie au LSD si leur demande est soutenue (et ensuite administrée) par leur médecin ou leur psychiatre, de l’autre l’exception religieuse permettra aux peuples autochtones amazoniens et américains de continuer leur usage sacramental de certaines substances (l’ayahuasca, contenant de la DMT pour les premiers, le peyote, contenant de la mescaline pour les seconds).
Aujourd’hui, les thérapies psychédéliques sont une réalité en Suisse, au Canada (là aussi grâce à un système fonctionnant au cas par cas), au Danemark (pour la psilocybine seulement), et en Australie (depuis 2024).
Ailleurs, l’usage des substances psychédéliques est au mieux dépénalisé, rarement décriminalisé. En France, depuis 2020, la possession de substances psychédéliques relève d’une amende forfaitaire (cas de dépénalisation).
En Espagne la possession de petites quantités de substances psychédéliques a été décriminalisée, ce qui est le cas aussi du Portugal, pionnier en la matière pour avoir autorisé l’usage de toutes les drogues depuis 15 ans. La kétamine (un psychédélique au sens “étendu” du terme) est sans doute la substance la plus répandue de manière légale (mais encadrée), car elle fait déjà l’objet d’un usage médical.
Aux États-Unis, de nombreuses cliniques de kétamine ont vu le jour pour traiter la dépression (avec un bilan thérapeutique et économique très mitigé) alors que le ministère de la Santé américain vient de refuser la mise sur le marché d’une thérapie par MDMA pour le traitement du stress post-traumatique. Des villes et des États ont cependant légalisé l’usage personnel de certaines substances psychédéliques, suppléant la loi fédérale.
Et les essais en France ?
Actuellement en France il y a deux essais cliniques en cours : un au CHU de Nîmes, dans l’équipe d’Amandine Luquiens, et l’autre à L’hôpital Sainte-Anne à Paris dans l’équipe de Lucie Berkovitch et sous l’égide de la startup britannique Compass Pathways. Une demi-douzaine d’autres essais cliniques sont en préparation à divers stades d’avancement et les autorisations à obtenir des institutions publiques relèvent parfois du parcours du combattant.
Par exemple, comme Dominique Nora le notait dans son interview, Luc Mallet qui est psychiatre, chercheur et professeur en psychiatrie, chef d’équipe au sein de l’Institut du cerveau et de la moelle épinière, attend depuis 4 ans un retour sur sa demande d’essai clinique pour une étude sur les psychédéliques. Même si nous ne sommes plus au point mort, la recherche reste timide et a pris énormément de retard par rapport aux autres pays ; l’enjeu pour la France est donc d’adresser le potentiel thérapeutique de ces substances avec beaucoup d’intérêt et de sérieux, et d’anticiper les prochains sujets de recherche pour conserver une place parmi les systèmes de soin les plus innovants.
Ce changement de perspective passera forcément par une meilleure connaissance et appréciation, de la part du grand public, des faits scientifiques concernant les substances psychédéliques et les autres traitements psychopharmacologiques en général, afin que la société, et en particulier les personnes atteintes d’un trouble mental, premières concernées, puissent avoir un véritable regard critique sur les opportunités de traitement qui leur sont proposées. De ce point de vue, scientifiques, personnels de santé, journalistes et activistes ont leur rôle à jouer dans le rétablissement des faits objectifs.
Comment agir grâce aux initiatives en cours
C’est sur le sujet de la sensibilisation que les efforts les plus importants peuvent être faits. Contrairement au marché anglophone, peu de livres en français ont été publiés sur la question psychédélique, qu’elle soit traitée d’un point de vue scientifique, anthropologique ou spirituel. Les sources d’information les plus sûres s’inscrivent généralement dans une démarche de réduction des risques, et à ce titre la Société psychédélique française propose un manuel de réduction des risques qui peut être téléchargé librement en ligne. Les choix concernant les sujets de recherche financés dépendant du ministère de la Santé, c’est au niveau politique, local comme national, que des actions peuvent être entreprises.
C’est le cas de PsychedeliCare, une initiative européenne qui prend la forme d’un référendum d’opinion citoyenne ouvert depuis le 14 janvier dernier et qui cherche à réunir 1 million de votes pour faire agir la Commission européenne sur trois sujets concrets :
• l’établissement de standards européens pour l’accès aux soins et la formation des thérapeutes psychédéliques,
• le renforcement du financement de la recherche concernant les substances psychédéliques,
• l’ouverture d’une discussion sur la reclassification de l’usage thérapeutique des substances psychédéliques, en accord avec les faits scientifiques établis concernant leur dangerosité et leur potentiel de soin.
Une vingtaine d’équipes nationales ont entamé des actions locales pour ouvrir le débat et convaincre le grand public du bien-fondé des ces thérapies, aidées par plus de 25 partenaires européens comme la Société psychédélique française, Decriminalize Nature France, MAPS Europe, PAREA, etc.
Le 6 février prochain, se tiendra au sein du Parlement Européen une demi-journée de conférences sur le sujet des thérapies psychédéliques, coorganisée par PAREA et présentée par David Nutt, en attendant l'événement de lancement sur le territoire français, attendu mi-février et qui devrait rassembler partenaires locaux, journalistes et chercheurs.
D’ores et déjà tous les citoyens européens ont la possibilité de soutenir l’initiative en ligne, directement sur le site de la Commission Européenne (les informations disponibles sont traduites dans toutes les langues du territoire) et il va sans dire que l’INEXCO soutient fortement cette opportunité de regarder avec objectivité les opportunités thérapeutiques apportées par les substances psychédéliques face aux troubles de santé mentale qui sont devenus les maux majeurs des sociétés occidentales.

Il est également possible de rejoindre l’équipe française des activistes PsychedeliCare en écrivant un e-mail à france [@] psychedelicare.eu