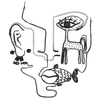Politique de l’invisible : pourquoi la transe a été marginalisée
Longtemps marginalisée par la science moderne, la transe revient aujourd’hui comme objet légitime : entre peur, contrôle et redécouverte, une politique de l’invisible s’esquisse.
La transe accompagne l’humanité depuis toujours. Pourtant, dans nos sociétés modernes, elle a longtemps été reléguée dans l’ombre : un phénomène suspect, entre superstition et pathologie. Comment expliquer que cette expérience universelle, porteuse de soin et de créativité, ait été ainsi marginalisée ?
Un héritage de peur et de contrôle
Dans l’Europe rationaliste du XIXe siècle, les états de conscience non ordinaires inquiètent. La médecine et la psychiatrie les classent comme symptômes : hystérie, folie, suggestion dangereuse. Charcot met en scène ses patientes en transe à la Salpêtrière. Freud y voit l’expression d’un inconscient qu’il faut dompter. L’expérience vécue, intérieure, est réduite à un spectacle ou à une anomalie. Derrière ce rejet se profile une peur : celle de perdre le contrôle, de voir s’effriter la frontière entre raison et altérité.
La domination du matérialisme/physicalisme
La montée en puissance du paradigme biomédical a renforcé cette marginalisation. La conscience est pensée encore majoritairement comme un épiphénomène du cerveau. Tout ce qui échappe à la mesure est suspect. La transe, expérience subjective, échappe au cadre. Elle dérange, car elle montre que l’humain peut activer en lui des ressources qui défient les explications mécaniques.
Un soupçon qui persiste
Encore aujourd’hui, le mot transe reste l’objet d’un soupçon implicite. On l’associe volontiers au charlatanisme, aux sectes, aux illusions collectives. Le vocabulaire trahit ce biais : on parle encore de « perte de contrôle » voire d’« emprise ». Pourtant, les mêmes états, nommés autrement — méditation, flow, hypnose clinique —, sont progressivement intégrés et valorisés. La différence est moins dans l’expérience que dans la reconnaissance institutionnelle.
Basculement en cours
Depuis une vingtaine d’années, un basculement discret s’opère. Des chercheurs, des cliniciens, des artistes réouvrent le champ. Les neurosciences, l’anthropologie et la psychologie phénoménologique donnent des langages nouveaux pour décrire la transe cognitive auto-induite. Des patients témoignent de ses effets thérapeutiques. Des traditions vivantes dialoguent avec la science. Peu à peu, la transe quitte la marge pour devenir objet légitime d’étude et de soin.
L'ontologie de l’invisible
Ce basculement n’est pas seulement scientifique. Il est ontologique. Car reconnaître la transe, c’est reconnaître que la conscience échappe aux modèles dominants. C’est admettre que l’humain n’est pas seulement un corps-machine, mais un être capable d’explorer et de transformer ses propres états d’être. C’est ouvrir la possibilité d’un autre rapport à la santé, à la créativité, à la société elle-même.
La transe, en ce sens, est une politique de l’invisible. Une invitation à remettre en cause les hiérarchies établies entre raison et altérité, science et mythe, normalité et différence. Elle nous rappelle que ce qui a été longtemps tenu à l’écart peut devenir une clé de transformation.
L'article suivant dans la série :
𒆖 Transe et créativité : ouvrir les portes du sensible
Les articles de la série Transe cognitive – science, art et société :
𒆖 Cartographier la transe : des mythes aux neurosciences
𒆖 La transe comme médecine invisible : entre traditions et sciences
𒆖 Politique de l’invisible : pourquoi la transe a été marginalisée (vous êtes ici)
𒆖 Transe et créativité : ouvrir les portes du sensible
𒆖 Transe et société : vers une écologie intérieure
𒆖 La transe cognitive auto-induite (TCAI) en 3 min