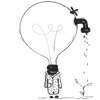Le temps, ce grand malentendu
Une exploration du concept du temps via les conférences du physicien et philosophe des sciences Étienne Klein.
Nous vivons dans le temps comme des poissons dans l’eau. Nous le respirons sans y penser, nous le nommons sans le définir. Mais à peine tentons-nous de le saisir qu’il se dérobe. Physiciens, philosophes, poètes : tous s’y affrontent, et tous se heurtent à ses paradoxes. Et si le temps était moins une chose qu’un malentendu — fertile, vertigineux, inépuisable ?
un mot aux mille visages
« Le temps passe », « le temps s’accélère », « je n’ai pas le temps ». Ces expressions semblent naturelles, mais elles reposent sur des images contradictoires.
Paul Valéry l’avait noté : nous comprenons le mot temps dans une phrase parce que nous parlons vite ; isolé, il se change en énigme.
Un fleuve s’écoule dans un lit immobile. Mais si le temps s’écoule, dans quoi s’écoule-t-il ? Si l’on dit que le temps s’accélère, alors il faut lui attribuer une vitesse… mais une vitesse se définit toujours par rapport au temps. On se retrouve piégés dans des tautologies absurdes.
Le langage multiplie les malentendus : nous appelons « temps » à la fois la succession, la simultanéité, la durée, le changement, l’attente, la vitesse, le devenir. Tantôt nous parlons de temps cosmologique, biologique, psychologique, postal même.
En vérité, le mot temps est un labyrinthe polysémique où nous nous perdons.
le paradoxe de l’ancestralité
La philosophie a longtemps débattu : le temps est-il une production de la conscience, ou bien une réalité indépendante ? Si nous choisissons la première option, un problème surgit : comment le temps a-t-il pu « passer » avant l’apparition de la conscience humaine ?
L’univers a 13,7 milliards d’années. La Terre : 4,5 milliards. La vie biologique : 3,5 milliards. Le genre homo, avec sa conscience réflexive, 2,5 millions seulement. L'homo sapiens : 300.000 ans. L’immense majorité de l’histoire cosmique s’est donc déroulée « sans nous ».
Si le temps dépend du sujet, comment a-t-il pu exister avant le sujet ? Ce paradoxe — que Klein appelle « paradoxe de l’ancestralité » — contraint à admettre que le temps possède une forme d’autonomie. Même si l’humanité disparaissait, le temps continuerait de s’écouler.
le moteur invisible
Admettons que le temps soit une réalité en soi. Reste à comprendre ce qui le fait avancer. Car dès qu’un instant surgit, il est aussitôt remplacé par un autre. Pourquoi ? Quel est ce moteur mystérieux qui renouvelle sans cesse le présent ?
La physique le représente par une ligne, un axe orné d’une flèche. Mais cette flèche ne dit pas pourquoi ça avance. Kant déjà critiquait cette spatialisation du temps : comment une juxtaposition de points peut-elle engendrer du successif ?
Nous voyons l’aiguille d’une montre se déplacer. Mais la durée pure, nous ne la voyons jamais. Comment d’instants de durée nulle naît une durée non nulle ? Comment d’une addition de zéros surgit une grandeur ?
La durée est peut-être la chose la plus mystérieuse qui soit.
cours du temps et flèche du temps
Etienne Klein insiste sur une distinction capitale entre cours du temps et flèche du temps.
- le cours du temps : la succession irrévocable des instants. On ne peut pas rester à T, il faut passer à T+1.
- la flèche du temps : l’irréversibilité des phénomènes. Le lait versé dans le café ne reviendra jamais au lait et au café séparés.
Dans le langage courant, nous confondons les deux. Nous disons que « le temps nous fait vieillir », alors que c’est le devenir biologique qui altère nos corps. Le temps, lui, ne nous fait rien. Il est ce qui laisse advenir.
Un artiste l’a exprimé avec force : Roman Opałka, qui peignait chaque jour la suite des nombres entiers sur fond noir, tout en se photographiant. Les nombres — toujours nouveaux, toujours semblables — incarnaient le cours du temps. Son visage, qui se transformait d’année en année, montrait la flèche du temps. Deux réalités distinctes, que nous confondons sans cesse.
le temps n’est pas coupable
Cette confusion nourrit une illusion : nous accusons le temps de nos pertes, de nos angoisses, de nos morts. Mais ce n’est pas le temps qui nous fait vieillir, c’est la vie qui se déploie en lui. Ce n’est pas le temps qui nous tue, ce sont les processus biologiques et cosmiques qui adviennent en lui.
Dire « je n’ai pas le temps » est une façon de parler qui masque une tout autre réalité : nous avons toujours le temps, mais nous choisissons de le consacrer à autre chose. Ce n’est pas un problème de temps, mais de liberté.
C’est pourquoi Etienne Klein aime rappeler : la vie ne se donne pas « pour après-demain ». Elle se donne dans l’éclat singulier du présent, cet instant irréductible qui ne reviendra jamais.
le vertige d’un mystère relationnel
Alors, qu’est-ce que le temps ? Peut-être rien d’autre qu’une fractale de relation. Relation entre événements (avant/après, simultanéité, rythme), ou relation entre le sujet et le monde (attente, impatience, mémoire, anticipation).
Nos états de conscience transforment notre rapport au temps.
Dans la méditation, il s’étire. Dans l’ennui, il s’alourdit. Dans la transe, il se dilate. Dans l’amour, il se suspend.
Le temps n’est pas une substance à mesurer : il est la texture mouvante de notre expérience.
𒆖 Le temps, disait saint Augustin, est ce que nous savons si bien jusqu’au moment où l’on nous demande de l’expliquer. C’est peut-être sa force : demeurer une énigme. Plutôt qu’une chose à définir, le temps est une invitation à vivre.
Apprendre à ne pas le confondre avec le devenir. Cesser de l’accuser de tous nos maux. Comprendre qu'il est flexible dans la conscience. Et honorer, dans la plus grande attention, la singularité des instants.
Pour aller plus loin :
Sur Youtube : conférences d'Etienne Klein sur le temps