Entretien avec Dominique Nora, grand reporter au Nouvel Obs et autrice
"Il y a des pistes thérapeutiques prometteuses : pourquoi est-ce qu'on ne les explore pas en France ?"
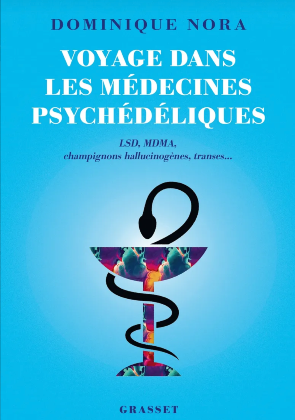
À l'occasion de la sortie de son livre "Voyage dans les médecines psychédéliques", et à l'approche du lancement de la campagne de signature de l'initiative PsychedeliCare, nous avons rencontré Dominique Nora pour parler du potentiel thérapeutique de ces substances souvent décriées, mais surtout mal connues. Vous retrouverez ci-dessous l'ensemble de notre échange, alors qu'un fascicule synthétique enrichi d'extraits sonores est consultable ici.
Retranscription de l'entretien
L’interview a été légèrement éditée par souci de clarté, sans changer les propos des intervenants.

– Dominique Nora, vous publiez un livre intitulé "Voyage dans les médecines psychédéliques" (Éd. Grasset, sorti le 8 janvier), sujet sur lequel vous aviez déjà écrit précédemment. Qu'est-ce qui pousse une journaliste à enquêter sur les psychédéliques aujourd'hui en France ?
– En tant que grand reporter au Nouvel Obs, je me suis intéressée au sujet après avoir lu le livre de Michael Pollan, qui est vraiment le livre de référence américain sur le sujet, à l'américaine, c'est à dire très touffu, très dense. Lui a essayé ces thérapies psychédéliques, il est remonté dans l'histoire, et par contraste, j'ai été abasourdie par la méconnaissance et le manque d'information en France sur les possibilités thérapeutiques des psychédéliques. C'est tout un pan d'histoire de la recherche des années 50-60 qui a été complètement rayé de la carte par la "guerre aux drogues" de Richard Nixon. Et la renaissance d'un intérêt pour les possibilités d'innovation en santé mentale, qui a eu lieu plus tard aux États-Unis et d'autres pays comme l'Australie, voire pour une certaine part en Europe, reste elle aussi ignorée.
Or, la santé mentale est dans une crise historique, avec 300 millions de personnes en dépression sur la planète, des gens en addiction, en stress post-traumatique, des désordres alimentaires, et beaucoup sont dans une impasse thérapeutique. Et moi, je suis fascinée par l'innovation. Quand une innovation apparaît dans une discipline, je me dis : il faut absolument faire connaître ces possibilités. Et j'ai été convaincue par le livre de Michael Pollan, et ensuite par mon enquête, qu'il y a effectivement des gens dont ça peut sauver la vie quand ils sont dans des cas suicidaires ou en dépression. Donc je me suis attelée à faire une cover du Nouvel Obs qui est parue au printemps 2021, et chemin faisant, j'ai moi aussi essayé une thérapie psychédélique parce beaucoup de gens m'ont dit : "Tu ne peux pas en parler précisément si tu n'essayes pas".

Il se trouve que c'était à un moment de ma vie où je pensais que ça pourrait me faire du bien, et surtout j'étais convaincue que ce n'était ni toxique ni addictif, et que je ne courais pas de danger en le faisant. Mais le plus important reste que la France est quand même très en retard sur la recherche et la science, et ces possibles innovations qui peuvent sauver la vie des gens.
– La couverture dont vous parlez date de 2021, donc à peu près au moment du Covid. Depuis, on a vu effectivement dans les médias français diverses couvertures du mouvement du microdosage et des thérapies psychédéliques, parfois underground. La France a un cadre légal strict par rapport à ces substances ; aujourd'hui, il n'y a pas de thérapies psychédéliques accessibles au grand public : est-ce que ça joue dans votre regard de journaliste par rapport à ce sujet ?
– Bien sûr, parce que lors de l'enquête, ce qui m'a frappée, c'est le cas de la Suisse : un pays voisin qui nous ressemble beaucoup et dont on peut supposer que les responsables ne sont pas des fous furieux des drogues. En Suisse, à l'hôpital comme en privé, les patients ont la possibilité d'avoir recours à des thérapies psychédéliques. Il faut demander l'autorisation, ce sont des psychiatres qui les administrent, patient par patient, substance par substance, mais j'ai recueilli des témoignages de patients suisses qui étaient en dépression depuis des décennies, que les thérapies psychédéliques ont complètement sorti de l'ornière, et qui ont aujourd'hui des vies normales.
Donc on peut se demander pourquoi en France, pays de science, avec de bons psychiatres, de bons addictologues, où les gens sont friands de psychothérapie, et qui affiche un record de consommation d'antidépresseurs, on ne suivrait pas l'exemple suisse : faire avancer la science, la recherche et les essais cliniques sur ce sujet pour donner accès au plus grand nombre à ces thérapies prometteuses.
– Est-ce que vous avez trouvé des éléments de réponse, dans votre recherche, sur la racine du problème dans notre société par rapport à cette question ?
– Je pense que le retard français est multifactoriel. Il y a eu des essais cliniques à Sainte-Anne dans les années 50, mais qui apparemment, d'après les historiens, ont été faits de manière peu bienveillante vis-à-vis des patients. Ils étaient conduits en environnement hospitalier, or les expériences américaines ont montré que ce qui est appelé le "set and setting" – c'est-à-dire l'intention du patient mais aussi la manière dont il est encadré, le contexte d'accueil dans lequel il fait son voyage – conditionne complètement le succès de la thérapie.
Donc il faut tenir compte de ce syndrome historique, mais aussi, et je crois que c'est le facteur le plus important, de l'état de notre psychiatrie où les soignants ont à peine les moyens de faire correctement leur travail. Donc tout ce qui relève de la recherche scientifique, du dépôt de projets d'essais cliniques, prend du temps et de l'énergie. Il faut aussi obtenir les financements – qui en France sont publics, alors qu'aux États-Unis c'est de l'argent privé qui a financé la recherche et les essais cliniques. Enfin, il y a une aversion au risque bien connue dans notre pays, qui ne concerne pas seulement la recherche psychédélique mais qui est très générale. Et je crois aussi qu'on a une culture très répressive vis-à-vis de tout ce qui est qualifié de drogue, même si les psychédéliques sont des "drogues" très différentes de drogues addictives comme l'héroïne par exemple, ou même l'alcool qui est très addictif mais lequel on a paradoxalement une culture plutôt permissive.
C'est tout cet ensemble de facteurs qui explique notre retard. Heureusement les essais cliniques démarrent tout juste : il y a eu un essai pilote au CHU de Nîmes, champignons hallucinogènes contre alcoolisme et dépression, et à Sainte-Anne démarre un essai avec une start-up britannique sur les champignons contre la dépression. Donc c'est en route, une demi-douzaine de projets sont en attente de feux verts, et je pense qu'il faut vraiment que les autorités prennent ce sujet à bras le corps et poussent la science et l'innovation pour le bien des gens qui se trouvent dans des impasses de santé mentale.
– Dans votre livre, vous commencez effectivement par cette citation : "Tu ne peux pas bien traiter le sujet toi-même si tu ne voyages pas." Quelles ont été vos motivations personnelles pour ce voyage ? Et qu'avez-vous tiré de cette expérience ?
– Il se trouve que c'était un moment très particulier de ma vie parce que je venais de quitter la direction de la rédaction du Nouvel Obs, et je cherchais un sujet pour me relancer. Ce sujet m'a attirée, je pense que ce n'est pas un hasard, parce que j'étais aussi dans un moment de déprime dû à deux deuils familiaux, en plus d'une séparation, donc c’était la conjonction de trois chocs émotionnels très forts.
Je me suis dit : je ne risque rien à essayer cette thérapie et peut-être qu'elle va m'aider à retrouver un état mental plus positif. Et en effet, ça a été une introspection très rapide, profonde et fructueuse, qui m'a permis de sortir de ma déprime à ce moment-là. Surtout, ce que j'ai senti, c'est que cette introspection, venait du cœur et des tripes, et pas du mental. J'avais eu des épisodes de psychothérapie avant, et c'était toujours le mental qui était aux commandes.
Là, ce sont les émotions qui sont aux commandes. On remet en perspective tous ses problèmes ou ses traumas. Ça permet, la science l'a montré, une plasticité neuronale qui fait qu'on ne regarde plus la vie de la même manière, ni ses rapports à soi-même, aux autres ou au monde. Une ouverture se produit dans l'esprit qui est vraiment thérapeutique. Pour moi, c'est un réel accélérateur de psychothérapie.
– Ça rejoint le témoignage d'une psychologue de mes amies qui, après avoir pris pour la première fois une substance psychédélique lors d'une retraite au Pays-Bas, a immédiatement transposé le potentiel de guérison que ça pouvait apporter dans le cadre de son métier. Avec le recul, que retenez-vous, en tant que journaliste, quant au potentiel de soin de cette thérapie ?
– Bien au-delà de mon expérience, ce sont tous les témoignages que j'ai recueillis pour mon livre qui ont forgé ma conviction. J'ai parlé à des gens qui ont été en essai clinique aux États-Unis, notamment avec la MDMA, qui est le principe actif de l'ecstasy, sur le stress post-traumatique. C'est l'indication vraiment identifiée pour laquelle une approbation légale était très proche d'être donnée aux États-Unis l'été dernier – mais je pense que c'est qu'une question de temps… C'est le cas de femmes qui ont été abusées sexuellement, ou des vétérans des guerres américaines… J'ai reçu beaucoup de témoignages de gens qui ont été engagés sur des terrains de guerre au Vietnam ou en Afghanistan, et qui m'ont dit : "J'étais suicidaire. Peut-être que je ne serais plus sur cette planète si je n'avais pas fait ces thérapies à la MDMA."
J'ai pu interviewer aussi des patients suisses, qui ont fait des thérapies avec diverses substances – incluant le LSD, car la Suisse est le seul pays qui autorise des thérapies au LSD, y compris à l'hôpital de Genève. Ces témoins m'ont dit : "Ça nous a sorti de notre état dépressif qui nous empêchait de vivre". Moi-même, je n'étais pas dans ce cas extrême heureusement, et je pense que les psychothérapies pour le grand public sont une chose, mais que l'urgence est de donner accès à ces thérapies, dans un cadre sûr, contrôlé et accessible, aux personnes qui se trouvent dans des situations désespérées. Parce qu'il reste un problème de coût, mais dans des sociétés modernes, où la science peut jouer un grand rôle, il est urgent qu'on s'intéresse à ces problèmes et qu'on fasse avancer cette cause.
– Vous dites qu'il est question ici de soigner des gens pour qui presque tous les traitements ont échoué, qui n'ont plus d'options thérapeutiques devant eux et dont on ne sait plus comment soulager les maux via des traitements médicamenteux ou d'autres formes de thérapies. Donc des gens pour qui ces approches sont le dernier espoir possible.
– Absolument. Les traitements existants reposent beaucoup sur les antidépresseurs, des médicaments qui soignent les symptômes, c'est-à-dire qu'on prend une pilule tous les jours pour continuer à vivre et à fonctionner. Mais d'une part, il y a beaucoup de gens pour qui ça ne marche pas, d'autre part, quand on les arrête, on retombe dans un état de dépression. Alors que l'espoir avec les psychédéliques, c'est de s'adresser aux causes, c'est-à-dire de donner à l'individu les moyens d'aller à la racine de ses problèmes psychiques et de les résoudre une fois pour toutes. Ce que j'ai ressenti à travers mon expérience personnelle, c'est que des traumas qui étaient des problèmes énormes sont mis en perspective. On se dit : "Oui, ça a existé, mais ça ne me définit pas, ce n'est pas moi". C'est le vécu que m'a confié aussi une femme violée par son patron dans un séminaire professionnel et qui n'arrivait plus à vivre. Elle m'a dit : "Avant je m'identifiais à cet abus sexuel, je m'identifiais à une victime. J'ai retrouvé une vie en comprenant que oui, ça a existé, mais ce n'est pas moi."
Ça montre la puissance du changement de perspective qui peut s'opérer grâce à ces thérapies psychédéliques. Et je précise bien : thérapie, parce que ce n'est pas seulement la molécule qui produit l'effet, c'est le travail psychothérapeutique qui l'accompagne. La substance est un accélérateur de travail psychothérapeutique.
– Les recherches en cours insistent là-dessus : c'est vraiment la conjonction de la molécule et de la thérapie associée qui soigne.
– Absolument.
– Dans votre livre, vous racontez que vous avez participé à des conférences scientifiques en Europe et aux États-Unis, où vous avez pu mesurer les avancées de la recherche. Aujourd'hui, dans le monde, les États-Unis mènent la course côté recherche avec, comme vous l'avez dit, des fonds privés, l'Australie a autorisé les thérapies psychédéliques, et en Europe, on est plutôt derrière. Pensez-vous que l'Europe doive suivre le modèle américain ou y a-t-il des alternatives possibles ?
– L'avantage du modèle des États-Unis c'est qu'il y a beaucoup d'argent qui finance la recherche, mais ces financements sont presque entièrement privés, donc spéculatifs. Ce sont les mêmes fonds d'investissement, les mêmes capital-risqueurs qui ont fait le succès d'Internet et des grandes plateformes, et ce sont des gens qui veulent avant tout gagner de l'argent.
Certains ont des motivations d'intérêt général, comme Rick Doblin et MAPS, qui est une association, mais l'essentiel des fonds est privé, et donc il y a une dérive spéculative aux États-Unis. On le voit avec la prolifération de cliniques de kétamine, une des substances associées aux psychédéliques mais qui peut avoir des effets toxiques, et il y a des abus. La mort de l'acteur Matthew Perry a illustré ça récemment. Ces dérives spéculatives entraînent un aveuglement et des risques.
Il faudrait développer en Europe un modèle beaucoup plus centré sur l'intérêt général, donc sur fonds publics, avec un objectif de santé accessible à tous. Les soins qui entrent dans le cadre européen doivent être beaucoup plus inclusifs et accessibles, car les gens qui en ont le plus besoin n'ont souvent pas les moyens de payer des cliniques très chères. Donc le modèle américain n'est pas bon en Europe. C'est à la puissance publique de faciliter les essais cliniques et de façonner un modèle qui soit vraiment inclusif.
– Que penser de cette vogue des cliniques à kétamine ?
– Elles ouvrent comme des salons de coiffure ! D'ailleurs, on n'a même plus à se rendre à la clinique, on commande ! Parce que pendant le Covid les gens ne se déplaçaient plus. Donc on peut commander les pilules de kétamine chez soi. De ce fait, on perd tout contrôle sur les abus et sur la manière de savoir si les gens sont bien accompagnés… Il ne faut pas prendre ces substances tout seul, il faut des accompagnants formés, parce qu'il peut y avoir des visions dérangeantes, des "bad trips" où les gens font des voyages qui leur font peur – ce qui peut aussi faire partie de la thérapie mais seulement s'ils sont accompagnés pour le vivre.
– Donc on fait face à deux approches opposées : d'un côté une vision économique avec diminution des coûts, téléconsultations, consommation du petit losange de kétamine tout seul chez soi avec le risque de mauvaises expériences mais aussi insuffisance d'un travail "d'intégration" des bénéfices thérapeutiques ; et à l'inverse, un encadrement de soin approprié, l'interaction avec un médecin, un psychologue, un psychiatre... un suivi dans la durée au bénéfice du patient mais au "détriment" de la rentabilité.
– Tout à fait, et une des pistes à mon avis pour un modèle plus accessible, ce sont les thérapies de groupes. J'ai vu par exemple des cas d'angoisse de fin de vie, chez des malades atteints de cancers en phase terminale. Ces gens font face à une perspective de mort à échéance de quelques mois. Un terme inéluctable. Donc ils subissent des angoisses, des dépressions profondes qui les empêchent de vivre ce qu'ils pourraient encore vivre. Dans cette situation, certaines thérapies de groupes s'avèrent extrêmement fructueuses et font aussi baisser les coûts, puisqu'une équipe d'accompagnants peut prendre soin de 8 à 12 patients. J'ai recueilli le témoignage d'un homme, Canadien, dont la fin de vie a été transformée profondément et positivement par une telle thérapie. Cet homme est mort en août 2024, mais quelques mois plus tôt, en avril, je l'avais longuement interviewé en visio. Sa sérénité et son rapport paisible à l'imminence de son départ était quelque chose de très beau.
[...]
– Les études sur l'usage des psychédéliques en fin de vie montrent en effet que leur spectre s'étend jusqu'à la dimension spirituelle de notre relation à la mort, et une meilleure acceptation de notre condition.
– Beaucoup d'expériences ont montré que les gens pouvaient avoir des expériences mystiques même s'ils n'étaient absolument pas croyants ; mystiques au sens spirituel du terme, c'est-à-dire prendre conscience qu'on était une petite particule dans un grand cosmos et que finalement notre disparition n'avait pas l'importance subjective qu'elle pouvait avoir quand on pense à la mort d'un point de vue individuel. Après, il y a un profond débat quant à savoir si l'expérience mystique peut être considérée comme faisant partie de la thérapie, ce dont beaucoup d'experts discutent en ce moment.
– Nous nous sommes rencontrés autour de la sortie de votre livre, mais également pour présenter l'initiative PsychedeliCare : une initiative européenne qui veut sensibiliser le grand public au potentiel des thérapies psychédéliques, et se présente sous la forme d'un référendum d'opinion citoyenne qui s'est ouvert le 14 janvier 2025. La campagne, qui va durer un an, vise à rassembler les signatures de citoyens européens pour promouvoir la recherche, la démocratisation de l'accès aux soins, leur prise en charge par les systèmes de soins des pays dans lesquels ils seront disponibles.
La France est un pays historiquement réticent au potentiel thérapeutique des psychédéliques, et plus généralement aux médecines dites alternatives – on a parlé de la politique de répression sur l'usage des drogues en général, la crainte d'un caractère addictif ou de possibles dérives sectaires. L'État et ses institutions contrôlent beaucoup ce qui existe aujourd'hui en France. Aujourd'hui pourtant, on sait prouver le potentiel de ces substances, et c'est le cœur de votre ouvrage : selon vous, quels facteurs ont un rôle à jouer dans le rétablissement des faits ?
– D'abord, je pense qu'il y a urgence d'avancer sur un cadre légal parce que dans des milieux qu'on pourrait qualifier d'underground, des psychothérapeutes qui ne sont pas toujours formés, ou des chamanes, il arrive que certains administrent ces substances. Il existe un besoin, et ce besoin est tel que des thérapies illégales se développent pour y répondre. On risque alors de voir se reproduire le scénario des années 70, c'est-à-dire des accidents ou des abus, parce que les gens ne sont pas toujours formés ou bien intentionnés. Le risque corollaire est de voir un coup d'arrêt mis à la science ou aux usages légitimes, médicaux ou thérapeutiques. Il y a donc une urgence à avancer.
Ça demande un effort conjoint. D'une part de gens comme moi, journalistes qui informent sur ce qui existe à l'étranger et pourquoi il est nécessaire de s'intéresser à ces innovations thérapeutiques. D'autre part de citoyens convaincus. Des initiatives comme PsychedeliCare sont pour eux l'occasion de dire : "Oui, ça nous intéresse, et plutôt que de le faire clandestinement et de prendre des risques, on veut y accéder dans un cadre légal". Et bien sûr, les responsables et le personnel médical ont une parole à porter. Il existe aujourd'hui en France une demi-douzaine de psychiatres addictologues qui veulent vraiment pousser cette science. Les responsables politiques doivent ouvrir les yeux, s'intéresser à ce qui se passe à l'étranger et lire les études cliniques.
Encore une fois ce ne sont pas des marginaux ou des fous furieux qui s'intéressent à ça. Ce sont les grandes institutions hospitalo-universitaires américaines, les Johns-Hopkins, les Stanford, les NYU, et des neuroscientifiques de très haut niveau. La science nous donne les moyens de savoir ce qui se passe dans le cerveau avec ces substances, et pourquoi elles pourraient agir de manière plus intéressante que les antidépresseurs. Donc il faut faire avancer l'information, les faits et la science sur ces sujets. La société civile a un rôle à jouer pour pousser les responsables politiques à s'y intéresser.
– Rappelons à ce propos que le gouvernement Barnier avait prévu de faire de la santé mentale une priorité nationale pour 2025... Au cours de vos recherches pour l'écriture de votre livre, avez-vous entendu parler de politiques qui commençaient à s'intéresser à ces sujets ?
– Je n'ai pas fait d'enquête exhaustive sur les responsables politiques français, mais ce que j'ai vu me laisse penser que pour l'instant, même au niveau de l'information, ils ne sont pas vraiment au point. J'en veux pour preuve que les essais cliniques demandés, par exemple au sein de l'APHP, sont enlisés dans une bureaucratie entre l'INSERM, l'APHP et différents organismes... Prenons le cas de Luc Mallet, professeur à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, un expert on ne peut plus crédible. Il a une demande en cours pour un essai clinique sur le thème "LSD contre l'alcoolisme", un mal qui pèse en France 40 000 morts et 100 milliards d'euros de coût social par an. Donc lutter contre ce fléau devrait être une cause nationale. Pourtant, cet essai demandé depuis 4 ans est enlisé dans la bureaucratie française. Je ne vois pas l'explication rationnelle pour empêcher des scientifiques et médecins hyper compétents de faire des essais cliniques contrôlés pour essayer de lutter contre l'alcoolisme en France.
– L'enlisement est-il une façon d'éviter de se prononcer et de devoir argumenter formellement ?
– C'est un manque de volonté politique, dû probablement à un manque d'information aussi.
– Je reviens à ce que vous disiez sur le fait que des thérapies underground existent, via des facilitateurs dont on n'est pas en mesure de qualifier les compétences. C'est vrai que souvent, et en particulier aux États-Unis où c'est déjà une réalité dans certains États, il y a un manque de formations. [...]
– La formation est en effet absolument cruciale. Aux États-Unis, même s'il existe par exemple une formation à l'université de Berkeley, elle relève en général d'organismes privés. Mais il commence à y avoir beaucoup de gens formés aux États-Unis, alors qu'en France, les personnes qui veulent vraiment se former n'ont pour l'instant aucun lieu où le faire.
J'ai eu la chance, comme journaliste, de pouvoir observer la première formation donnée en France à l'hôpital Paul Brousse, où des spécialistes suisses et allemands qui avaient déjà pratiqué des essais cliniques sont venus former les médecins français. C'était intéressant parce qu'il y avait une simulation de voyage sous psilocybine, mais personne n'avait pu prendre la substance puisque c'était illégal. Des médecins, qui jouaient le rôle de patients, ont simulé des scénarios de bad trip pour essayer de confronter leurs collègues à des situations problématiques dans les voyages psychédéliques. Donc c'est un ensemble de choses qui se tiennent : l'existence de formations conditionne l'émergence d'essais cliniques, et c'est tout un écosystème à bâtir. Pour ça, il faut une volonté politique, et cette volonté politique peut être provoquée par des initiatives comme PsychedeliCare où la société civile prend la parole pour dire :
"Il y a des pistes thérapeutiques prometteuses : pourquoi est-ce qu'on ne les explore pas en France ?"
Un autre entretien qui pourrait vous intéresser :
Antoine Bioy : science, transe et exploration de la conscience

