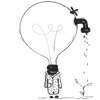Changer de carte du réel
Et si la réalité n’était pas faite de matière, mais d’expérience mentale ? Et si la conscience n’émergeait pas du cerveau, mais que le cerveau émergeait de la conscience ? Et si la crise de notre civilisation n’était pas d’abord économique, climatique ou technologique — mais métaphysique ?
Ce premier article de la série #Métarécit ontologique approfondit la rupture avec le matérialisme, en reconfigurant ce que nous entendons par “réalité”. Il expose un nouveau socle narratif sur lequel d'autres visions peuvent s'ancrer.

La carte n’est pas le territoire… sauf quand elle le devient
Depuis des siècles, notre compréhension du monde repose sur une hypothèse aussi discrète que puissante : la matière serait première.
Le réel, tel que nous le concevons collectivement, serait composé d’objets physiques, étendus dans l’espace, obéissant à des lois causales, indépendants de l’observateur. La conscience ? Un sous-produit tardif et localisé de processus neuronaux. Une bulle de subjectivité dans un monde extérieur indifférent.
Mais une carte n’est pas innocente. Lorsqu’elle devient la seule carte disponible, elle finit par structurer nos perceptions, nos institutions, nos désirs — jusqu’à se faire passer pour le territoire lui-même.
Le matérialisme métaphysique est cette carte dominante. Et aujourd’hui, elle craque de toutes parts.
Le paradigme matérialiste est en crise — mais ses fissures sont niées
Dans les laboratoires, les phénomènes quantiques défient nos intuitions spatio-temporelles. En psychologie, la conscience reste un mystère insoluble — le « hard problem », comme on l’appelle — que les modèles computationnels ne parviennent pas à simuler. En médecine, les expériences de mort imminente, les rémissions spontanées, les effets placebo suggèrent des dynamiques qui échappent au seul corps.
Et pourtant, dans l’espace public, l’ancien paradigme règne toujours : la conscience serait produite par le cerveau, l’univers serait un mécanisme sans intention, et la subjectivité un bruit de fond sans portée.
Cette dissociation entre ce que nous savons (ou pressentons) et ce que nous disons (ou enseignons) engendre une perte de sens, un déracinement existentiel, et une forme de schizophrénie collective. L’écocide, la marchandisation du vivant, l’aliénation numérique sont les symptômes visibles d’un monde gouverné par une carte périmée.
Une proposition radicale : la conscience est la base de la réalité
Face à cette impasse, une nouvelle carte se dessine. Elle s’enracine dans une intuition ancienne — partagée par les traditions contemplatives, certains physiciens, philosophes et chercheurs contemporains : la conscience n’est pas un effet secondaire du réel, elle en est la trame fondamentale.
Cette position porte un nom : l’idéalisme, et dans une déclinaison moderne, l'idéalisme analytique. Défendu notamment par Bernardo Kastrup, ce cadre propose que toute réalité est constituée d’expériences conscientes. Il n’y a pas de matière en soi, mais des perceptions dans un champ d’expérience partagé.
Les objets, les corps, les cerveaux eux-mêmes ne sont que les images, depuis une certaine perspective, de dynamiques internes au champ de la conscience.
Cela ne nie pas notre expérience de la réalité, mais elle l'englobe.
Ce n’est pas une croyance mystique, mais une thèse rigoureuse, argumentée logiquement, et de plus en plus soutenue par des données issues de la physique, des neurosciences et de ce qu'on nomme encore EMC (états modifiés de conscience).
Changer de carte, c’est changer de monde
Pourquoi est-ce si important ? Parce que notre manière d’agir dépend de notre manière de percevoir. Si le monde est un mécanisme, il est légitime de l’exploiter. S’il est une conscience, alors toute action est relationnelle. L’écologie cesse d’être une gestion des ressources, elle devient une éthique du lien. L’identité personnelle cesse d’être un agrégat de traits, elle devient une modulation de la conscience universelle. La politique cesse d’être une lutte de corps et d’intérêts, elle devient une orchestration d’expériences.
Changer de métaphysique, ce n’est pas simplement changer d’idée — c’est changer de posture intérieure, de regard, de narration collective. C’est oser imaginer que le monde n’est pas “là-dehors”, mais en nous — non pas de manière solipsiste, mais peut-être en tant que rêve commun d’un esprit plus vaste que nous.
La Gazette de l’INEXCO naît dans ce moment charnière. Elle ne prétend pas imposer une nouvelle carte, mais inviter à explorer celles qui émergent. Elle se veut laboratoire d’un nouveau récit : sensible, incarné, poétique et rigoureux. Un espace pour croiser les savoirs, honorer les expériences, et esquisser les contours d’un réel plus profond, plus vibrant, plus vivant.
La carte change. Le réel s’ouvre. Et nous sommes invités à le ressentir.
🧭 Pour aller plus loin
𒆖 Tous les articles de la collection "Métarécit ontologique"
𒆖 Tous les articles de la collection "Idéalisme analytique"
🎬️ Les failles cachées de notre vision du monde – Essentia Foundation
Une série de cours (en anglais) et une introduction synthétique au changement de paradigme idéaliste, ses racines philosophiques et ses conséquences scientifiques.
YouTube : les failles cachées de notre vision commune du monde| Dr Bernardo Kastrup
📘 Tout est relié - Univers Esprit de Romuald Leterrier et Jocelin Morisson
À partir de nombreux exemples issus des cultures natives, des traditions spirituelles et des dernières découvertes de la science la plus en pointe, le réseau cosmique se matérialise sous nos yeux et apparaît pour ce qu'il est : un vaste Esprit.