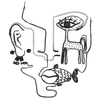Cartographier la transe : des mythes aux neurosciences
De la transe rituelle aux neurosciences, une nouvelle cartographie se dessine : science et mythe se répondent pour éclairer ces états de conscience oubliés.
Depuis la nuit des temps, les humains franchissent des seuils invisibles. Un tambour qui résonne dans la nuit, une danse en spirale qui accélère, un souffle qui se prolonge jusqu’à faire chavirer les sens. Les chamans, les mystiques, les poètes ont toujours connu cet art de se laisser traverser par d’autres états de conscience. Dans ces instants, le monde ordinaire s’ouvre, et une autre réalité se révèle : celle des esprits, des dieux, des ancêtres ou des visions intérieures.
La transe appartient au patrimoine immémorial de l’humanité. Elle se décline dans des formes innombrables : les oracles de Delphes, les derviches tourneurs, les cultes de possession en Afrique, les mystiques chrétiens absorbés dans l’extase, les chamans d’Amazonie ou de Mongolie. Partout, elle est à la fois pratique de soin, de reliance et d’accès à l’invisible. Mais chaque culture l’a habillée de ses propres récits : message divin, épreuve initiatique, guérison spirituelle.
Avec la modernité occidentale, la transe a basculé dans l’ombre. La science naissante, soucieuse de se démarquer des croyances, l’a reléguée au rang de superstition ou de pathologie. Dans les amphithéâtres du XIXe siècle, Charcot exposait ses patientes en état d’hystérie ; Freud y voyait l’expression d’un inconscient à décrypter. Anthropologues et psychiatres observaient la transe « de l’extérieur », comme curiosité exotique ou symptôme inquiétant. L’expérience intime, vécue de l’intérieur, disparaissait sous l’étiquette du trouble.
Pourtant, un retournement est en cours. Depuis une vingtaine d’années, des chercheurs explorent à nouveau la transe, cette fois avec les outils des neurosciences et des sciences humaines. En France, grâce au travail de Corinne Sombrun, l’expression transe cognitive auto-induite (TCAI) s'introduit dans notre champ lexical : elle désigne une capacité que chacun peut expérimenter, sans recours nécessaire à un cadre rituel ou religieux. Des études récentes, recensées par TranceScience, cartographient ces états : analyses textuelles de récits subjectifs (2024), mesures des variations du système nerveux autonome (2023), revues des expériences dites « hors du corps » (2025). EEG, IRM, text mining… les technologies modernes s’emploient à traduire l’indicible en données.
Cette démarche a un mérite immense : elle donne un langage commun, une légitimité scientifique, à une expérience longtemps marginalisée. Mais elle soulève aussi une question : que perdons-nous en réduisant la transe à des signaux neuronaux ou à des graphiques de cohérence cardiaque ? Peut-on vraiment enfermer l’infini du vécu dans les mailles de l’objectivation ?
Peut-être faut-il voir les choses autrement : non pas opposer mythe et science, mais reconnaître qu’ils se complètent.
Les mythes racontent l’épaisseur symbolique de la transe, son pouvoir de transformation. La science, elle, en éclaire les mécanismes, sans pour autant en épuiser le mystère. Les deux ensemble dessinent une nouvelle carte : une cartographie sensible et rationnelle, où le corps, l’esprit et la culture s’entrecroisent.
Cette carte est encore en train de se dessiner.
Elle invite à une autre question, qui nous guidera dans le prochain article : si la science commence à cartographier la transe, n’est-ce pas parce qu’elle pressent son potentiel ? Et si la transe, au-delà de l’expérience personnelle, devenait une médecine invisible, au service de notre santé et de notre humanité ?
L'article suivant dans la série :
𒆖 La transe comme médecine invisible : entre traditions et sciences
Les articles de la série Transe cognitive – science, art et société :
𒆖 Cartographier la transe : des mythes aux neurosciences (vous êtes ici)
𒆖 La transe comme médecine invisible : entre traditions et sciences
𒆖 Politique de l’invisible : pourquoi la transe a été marginalisée
𒆖 Transe et créativité : ouvrir les portes du sensible
𒆖 Transe et société : vers une écologie intérieure
𒆖 La transe cognitive auto-induite (TCAI) en 3 min