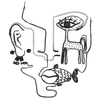Biodiversité : de la conscience de la séparation à l’interconnexion
Et si la biodiversité ne disparaissait pas simplement parce que nous détruisons la nature, mais parce que nous avons oublié que nous l'étions ?
Lors d’une conférence à la Fête de la Biodiversité, Andy Williams nous a emmenés dans une traversée inattendue. Entre humour franc, jardinage incarné et critique de nos formes de vie, il a fait apparaître un motif oublié : la lisière. Lieu d’abondance, d’interpénétration, de rencontre.
Et si ce motif nous aidait à penser un monde où l’humain retrouve sa place dans le vivant, non pas en revenant au centre, mais en redevenant interface sensible — lisière entre le dedans et le dehors, le connu et le mystère ?

Une conférence qui parle du vivant depuis le sol
Andy ne parle pas du vivant en théoricien. Il parle en jardinier, en cueilleur d’indices, en observateur joyeux.
Il raconte comment il a appris à ne plus tuer les limaces, mais à les nourrir intelligemment pour qu’elles laissent ses haricots en paix. Comment il cultive les pucerons pour attirer les coccinelles, gardiennes naturelles de son potager.
« La biodiversité, ce n’est pas une collection d’espèces. C’est un réseau de relations fonctionnelles. »
Et c’est à travers ces récits sensibles qu’il dévoile une vérité plus large :
notre société a organisé, à tous les niveaux, une séparation radicale entre l’humain et la nature. Une séparation qui engendre destruction, ignorance et perte de sens.
La séparation : une crise ontologique
À la racine de la crise écologique, il y a une faille dans notre manière de penser.
Nous avons mis la nature dehors.
Nous avons séparé les zones : agricoles, résidentielles, naturelles, industrielles.
Même dans nos discours écologiques, cette fracture demeure.
Andy le résume ainsi :
« Nous ne résoudrons pas la crise écologique avec des zones de nature. Cela ne fait que perpétuer la séparation. »
Cette séparation n’est pas seulement géographique ou politique. Elle est ontologique.
Elle repose sur l’idée erronée que nous serions séparés du monde. Que la conscience serait enfermée dans le cerveau, que la matière serait muette, que le vivant serait une ressource.
La lisière : là où la vie surgit
Mais le vivant, lui, n’obéit pas à la logique du centre.
Il déploie des fractalités, des ramifications, des interfaces multiples.
Dans un écosystème, la lisière — cet espace entre forêt et prairie, entre terre et eau — est là où se concentre le plus de biodiversité.
La lisière, c’est là où les mondes se rencontrent.
Là où les êtres tissent des alliances.
Là où l’instabilité devient fertilité.
À l’inverse, nos villes sont compactes, centrées, rationnelles. Leur géométrie trahit notre fantasme de contrôle. Plus le périmètre est petit, moins il y a de bordures.
Et pourtant, tout ce que la nature fait pour nourrir la vie, c’est multiplier les lisières.
La cellule, elle aussi, vit à sa lisière
Ce motif de la lisière se retrouve jusque dans l’infiniment petit.
La biologie cellulaire contemporaine montre que ce n’est pas dans le noyau que réside l’intelligence cellulaire, mais dans la membrane.
C’est elle qui perçoit, échange, décide. C’est elle qui entend le monde extérieur et y répond.
« On peut retirer le noyau d’une cellule, elle continue de vivre. Mais si on enlève la membrane, elle meurt. »
La membrane est une lisière vivante, un organe d’écoute, une interface consciente.
Et si l’humanité, comme super-organisme, n’avait pas besoin d’un centre plus fort, mais de membranes plus sensibles ?
Si la réponse n’était pas dans le renforcement du noyau, mais dans l’intensification de nos bordures vivantes ?
La conscience comme lisière entre les mondes
Ces observations résonnent avec ce que l’idéalisme analytique affirme : nous ne sommes pas séparés du monde — nous sommes des expressions localisées d’une conscience unique.
La lisière devient alors un motif de la conscience elle-même.
Un lieu de passage, de résonance, de tissage.
Et si la ville, le jardin, la cellule, l’attention… étaient des manières d’organiser nos seuils de conscience ?
Et si réintégrer le vivant commençait par redessiner nos formes, en nous et autour de nous ?
Repenser la ville : de la forme centrée à la forme vivante
Andy propose une vision simple, radicale, poétique :
Redessiner la ville non pas comme un cercle fermé, mais comme une étoile.
Faire des bras ouverts. Multiplier les lisières. Rendre la nature accessible à 500 mètres pour tous.
Il parle de mettre les écoles à la lisière, les hôpitaux dans des parcs, les zones de compost au contact des maraîchers, des chemins verts entre les quartiers.
Une ville comme un organisme fractal, nourrie par ses membranes.
Une ville où la bordure devient un espace commun, fertile, désirable.
Devenir espèce-lisière
Certaines espèces sont dites keystone : leur présence régule et transforme l’écosystème. Le castor crée des zones humides. Le loup stabilise la végétation. Le champignon relie les racines.
Et si l’humain redevenait une espèce-lisière ?
Non pas une espèce centrale, dominante, extérieure au vivant.
Mais une espèce-reliance. Une espèce qui écoute, qui connecte, qui orchestre.
Une voie d’éveillance
Penser la lisière, c’est réapprendre à habiter le monde en conscience.
À la croisée de l’écologie, de la biologie, de l’ontologie et du politique, la lisière devient un archétype de transformation : là où le monde se régénère. Là où l’humain redevient vivant parmi les vivants.
C’est peut-être cela, l’enjeu du siècle : élargir nos bordures. Cultiver nos membranes. Tisser de nouvelles interconnexions.
Non pour revenir à la nature, mais pour reconnaître que nous n’en sommes jamais sortis.
📚 Pour aller plus loin
- Conférence d’Andy Williams — L’importance de la bordure dans les écosystèmes (Youtube, 1h17)
- Articles INEXCO sur l’idéalisme analytique