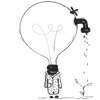Antoine Bioy : science, transes et exploration de la conscience

Antoine Bioy, professeur des universités en psychologie clinique et psychopathologie, est une figure incontournable de la recherche sur les transes et les états non ordinaires de conscience. Auteur et coordinateur du Grand livre des transes et des états non ordinaires de conscience (Dunod), il a rassemblé dans cet ouvrage de référence une cinquantaine de spécialistes pour explorer ces phénomènes sous un prisme scientifique, anthropologique et thérapeutique.
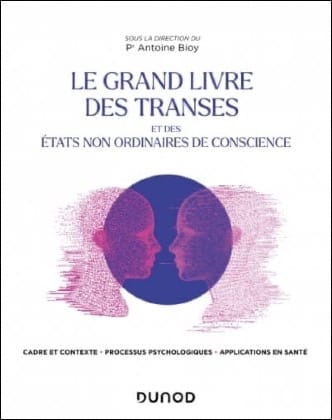
Il dirige également un Diplôme Universitaire (DU) à l’Université Paris 8, un programme unique en France qui propose une approche pluridisciplinaire des transes, réunissant chercheurs, cliniciens et praticiens.
Dans notre entretien, Antoine Bioy revient sur son parcours et partage sa vision des transes comme outils d’exploration, de transformation et d’accompagnement thérapeutique. Il aborde les enjeux scientifiques et sociétaux liés à leur reconnaissance, la place des psychédéliques, ainsi que l’importance de l’art et de la culture dans l’exploration de la conscience.
À travers son travail de transmission – que ce soit dans ses ouvrages, son enseignement universitaire ou ses recherches – il cherche à tisser des liens entre science et expérience, entre académisme et expérimentation, pour mieux comprendre la manière dont ces états transforment nos perceptions et influencent nos trajectoires personnelles et collectives.
L’entrée est gratuite et sur pré-inscription, en présentiel ou en ligne.
Plus d’infos ici 👉 lien et inscriptions ici 👉 lien
Retranscription de l'entretien
INEXCO
– En parcourant votre profil LinkedIn, on découvre une impressionnante diversité de pratiques, de qualifications et de responsabilités : professeur des universités en psychologie clinique et psychopathologie, docteur en psychologie, psychothérapeute, directeur de recherche, responsable ou coordinateur scientifique de plusieurs organisations… et auteur de nombreux ouvrages.
Plutôt que de retracer l’ensemble de votre parcours, comment définiriez-vous aujourd’hui votre identité professionnelle et ce qui vous anime ?
Antoine Bioy
– Il y a probablement deux lignes directrices. La première, c'est l'envie de transmission. Cette envie est présente dans l'ensemble des activités que vous avez citées et même thérapeutiquement avec les patients. Ma façon d'aborder les choses, peut-être influencée par Carl Rogers, c’est au travers de la pédagogie et la transmission. Apprendre de ses expériences demande à avoir quelques lignes directrices ; je ne les ai pas toutes, c'est clair, mais celles auxquelles je m'intéresse sont un peu décalées par rapport à celles qui traversent les patients et c'est cette complémentarité qui m’intéresse.
L’autre ligne directrice, c'est sans doute la jouissance. Il y a cette phrase de Brillat-Savarin qui est une sorte de mantra pour moi : “Il n'y a qu'un instant, c'est l'instant de la jouissance”. Ça fait aussi partie de ce qui me transporte, c'est-à-dire que je n'ai pas l'impression de travailler, je ressens la fatigue mais je ne m'ennuie pas une seconde, j'adore ce que je fais et il y a une vraie jouissance chez moi à pouvoir mener ce travail qui me fait rencontrer des personnes très différentes, me fait découvrir des thématiques, des expériences très diverses et parfois aussi très opposées ou très en contraste avec qui je suis, ma personnalité, mon éducation. C'est la découverte de mondes et il y a une vraie jouissance autour de ça.
Ces deux lignes directrices sont sans doute les fils directeurs de l'ensemble de mon activité, mais il y a quelque chose que vous n'avez pas cité auquel je tiens beaucoup (rire), c'est que je suis également auteur de livres de cuisine !
– Je ne le savais pas. Ça devrait être aussi sur LinkedIn !
– Cette dimension n'est pas qu'anecdotique pour moi, c'est-à-dire que la jouissance, celle dont parle Brillat-Savarin, c'est une jouissance des sens et la cuisine est le lieu où l'ensemble de la sensorialité est immédiatement convoqué. C'est un art majeur pour moi. On peut dire que je suis toujours à la recherche de ce qui va faire bouger les sens et la tête. Étant universitaire, chercheur, j'ai besoin de ma tête, c'est souvent comme ça que je rentre dans l'expérience. Ces deux mots-clés sont le fil rouge.
– Ça veut dire que vous avez été guidé par la curiosité envers différents centres d'intérêt, qui se sont nourris au fur et à mesure ?
– Oui, c’est une construction en parallèle, un peu curieuse. Au travers de mes études universitaires, la psychologie, je suis tombé sur un livre traitant de l'hypnose auquel je n'ai rien compris, mais qui m'a éveillé sur la question de “Qu’est-ce qu’un être humain ?” Même si j'ai failli abandonner mes études de psycho pour devenir animateur radio, j’ai suivi une carrière très académique, classique, avec une thèse derrière, etc. Il y a plein de mondes que je n'avais pas identifiés comme faisant partie immédiatement de ma route, mais qui étaient malgré tout présents. Le monde de la techno, des rave-party, le monde de la radio aussi, et particulièrement les émissions de nuit. J'adorais animer ces émissions, et dans les années 90-2000, il y avait encore un vrai rapport à l'auditeur que je trouvais absolument magique.
Académiquement et cliniquement, j’ai débuté dans le champ de la toxicomanie. Paradoxalement, je n'y ai pas vu du tout le lien avec les transes et les états de conscience modifiés. C'est assez récemment que j’ai réalisé le fil directeur entre la dimension académique et puis le reste de mes expériences, que j'ai considérées pendant longtemps comme des à-côtés. Quand on me demande : “Qu'est-ce qui t’a fait partir vers les transes ? Qu'est-ce que tu y trouves ? Qu'est-ce qui va se passer après ?” Je n'en sais trop rien, c'est trop tôt pour moi. Je n'ai pas encore le sens de la trajectoire ou du pourquoi, ou du contenu, de la substance que je vais au final en tirer. Je ne sais pas du tout où tout ça va m'amener. Mais en tout cas, il y a un maillage qui ressort entre ces deux parties de mon évolution.
– C'est la volonté de transmission dont vous parliez ? C'est-à-dire rassembler des sujets à la fois connexes, mais souvent traités de manière séparée dans les filières d'enseignement ou au niveau thérapeutique ? Une volonté de tisser des liens, et puis aussi d'ouvrir la porte à d'autres, qui n'auraient pas suivi le même parcours universitaire par exemple ?
– La transmission est un souci de partage. Oui, j'ai écrit plus de 20 livres, mais il y en a très peu que j'ai écrit seul. J'ai surtout fait de la coordination, j'ai travaillé “avec”. Comme avec l'expérience hospitalière : pourquoi est-ce que je fais de l'hôpital depuis toujours, depuis que je suis psychologue ? Parce que j'adore travailler avec les autres. J'ai une petite activité libérale, et à une époque j'ai essayé d'être libéral pur, mais ça ne me convient pas du tout. C'est vraiment pour travailler avec les autres. Le côté enseignant, c'est évidemment pour travailler avec les étudiants. Mais ma façon de rentrer dans l'expérience est une façon académique. Je n'arrive pas à être dans le partage tout de suite avec les autres. Il faut d'abord que je me positionne en posant les choses qui sont importantes pour moi dans le domaine des transes, ce que l'on sait et que je peux transmettre, ce que l'on ne sait pas… C'est après avoir installé ça que le partage commence.
Mon souci est d'installer la question des transes comme étant un objet scientifique. Ça n’est pas de la science de comptoir, ça n’est pas de la poésie. Je considère qu’il y a un vrai intérêt pour l'humanité, car cela touche à une dimension universelle, pleine de potentiel mais aussi de risque pour les individus de chuter, de boiter, etc. Il faut traiter le sujet avec sérieux et passion, mais surtout sérieux. Car les problématiques de transes, y compris l'hypnose et la méditation, nous donnent l'impression que tout est convenu et facile. Or, du côté des académiques et de la bien-pensance — ceux qui pensent être dans le vrai, la vraie science — comme de l'autre — ceux qui ne sont que dans l'expérience, il y a des radicalités qui créent un mur empêchant le partage du savoir. Cette dimension pédagogique est donc importante pour moi parce qu'elle me permet aussi de pouvoir être dans le dialogue et la construction avec mes interlocuteurs.
Dans moins d’un mois, on organise un troisième Colloque sur les transes à l'université. Les intervenants sont des gens que je ne connaissais pas il y a 5 ans pour la plupart. J'adore ça ! On va se rejoindre sur des sujets qui nous unissent, mais sur lesquels on a des niveaux d'expertise et d'intérêt très différents. C'est vraiment ça qui me motive ! Mais je reste un académique, un universitaire, et je milite pour dire la science. Et la science ne dit pas tout, elle n'est là que pour poser des questions et pour essayer de travailler les formulations des questions, et c'est là où l'expérience des autres est intéressante. Mais on ne peut pas être que dans l'expérience individuelle, parce que sinon on n'arrive pas à construire, on ne peut pas être que dans les études expérimentales. Je pense qu'il y a un vrai intérêt pour les deux parties à trouver un chemin commun.
– Justement, pour rentrer dans le sujet des transes, jeudi dernier, vous animiez un cours universitaire intitulé “Comment définir les transes et leurs fonctions ?” Le cours commençait par un dialogue avec l'assistance. Est-ce que vous pouvez nous donner une réponse rapide à cette question qui résume, j'imagine, le cœur de vos travaux ?
– C'est un état de conscience modifié d'abord, avec toutes les critiques qu'il peut y avoir là-dessus, un état de conscience non ordinaire qui a la particularité de s'installer quand il y a ce que j'appelle une brusquerie. Quand on regarde l’ensemble des auteurs et des domaines, les psychédéliques, le chamanisme, le néo-chamanisme, il y a un moment où on est délogé de son sens commun, de son attitude naturelle, comme une toupie qui sortirait tout d'un coup de son pivot. Et c'est dans ce moment où tout semble exploser, où on perd ses références, qu’on peut aussi redéfinir les choses autrement, parfois naturellement, parfois en étant aidé. Les transes sont caractérisées par cet élément de brusquerie. Elles ont des fonctions récréatives, qui paraissent évidentes, que je préfère plutôt appeler fonctions d'exploration, parce qu'il y a une intention d'âme qui cherche à trouver quelque chose ou à vivre quelque chose de particulier, et des fonctions thérapeutiques.
Ce dont je parlais aussi jeudi dernier, c'est la dimension sociétale qui est extrêmement forte. Par exemple, les mouvements nationalistes actuels font partie de la façon dont les transes sont au travail dans les sociétés, avec notamment ces grands mouvements de foules, ces leaders... Sans connaissance construite autour des transes, on a du mal à comprendre cette dimension, et on se demande si l'autre est fou, de la même façon qu'on se demandait si les chamanes étaient fous. Donc je vois trois dimensions : la dimension expérientielle, la dimension thérapeutique, la dimension sociétale. On pourrait y ajouter d’autres, notamment celle de la spiritualité. Tout ça représente quand même une grande partie de l'humanité !
– Tout à fait. Vous définissez donc la transe comme une sorte de super-exaltation des sens, de l'individu, de quelque chose qui lui est supérieur ?
– Je dirais plus une perturbation des sens qu'une exaltation. Il y a parfois le sentiment que quelque chose se délite, et ce n'est pas dans le sens de l'exaltation. Il y a en tout cas une perturbation, comme un orage des sens ; c'est une confusion des sens pour reprendre Rimbaud que je cite souvent et qui a écrit des choses merveilleuses là-dessus. Toutes études confondues, 70% des expériences sont des expériences positives, c’est à garder en tête, mais il y a quand même 30% d'expériences qui sont dans le champ soit du négatif, soit carrément du pathologique. Cela pose la question de comment est-ce que ça se guide, comment est-ce que ça s'oriente — quand il y a besoin d'être orienté, qu'est-ce qu'on peut faire et comment aller plus loin. Dans toutes les organisations humaines où les transes existent — le chamanisme est sans doute l'exemple même d'une transe officiellement installée dans une société — il y a un projet politique, une proposition de valeurs particulières, par exemple autour de la conscience écologique, des idées sur ce qu'est une organisation humaine, ou encore une fonction de lien entre les gens. Que l'on parle des derviches tourneurs, que l'on parle du soufisme, que l'on aille du côté du Maghreb, que l'on aille du côté des Pouilles, que l'on aille du côté de l'Amazonie, quand une transe est organisée, instituée, dans laquelle les individus vont vivre quelque chose, et qu'il y a reconnaissance de cette forme, derrière il y a des valeurs, un enjeu politique.
Dans notre société, c’est l’hypnose qui est reconnue ainsi. Ses valeurs et l'enjeu politique, c'est la question de l'autonomie du sujet. On parle toujours de l'hypnose et de l'autonomie par rapport à sa propre santé, l'auto-hypnose qui va derrière, etc. Ça n'est pas une idée qui va de soi, pour deux raisons : on peut tout à fait ne pas vouloir l'autonomie des individus dans une société, et l'autonomie, cliniquement, psychologiquement, ne convient pas à tout le monde. Certains individus ont besoin d'une dépendance à l'autre, au moins transitoire, et vouloir les engager vers l'autonomie les met sur le côté. Ce ne sont évidemment pas les mêmes valeurs que l'on va retrouver dans d'autres pratiques de transe, dans d'autres cultures. S'intéresser aux transes, c'est aussi s'intéresser à ce projet-là en particulier.
– Merci pour cette précision. Le livre que vous avez édité dernièrement, “Le grand livre des transes et des états non ordinaires de conscience”, c'est un ouvrage où vous avez collaboré avec beaucoup de personnes, je crois qu'il y en a presque 50.
– Oui.
– Et ce livre décrit un ensemble de contextes dans lesquels on peut vivre une transe. Quel commentaire faites-vous sur la perception globale des transes, vous en parliez brièvement tout à l'heure, dans le monde médical ou dans le monde thérapeutique ? Quels sont les enjeux selon vous pour aller vers une reconnaissance plus établie, plus objective de ces transes dans l'accompagnement thérapeutique ?
– Il y a un jeu de dupe qui s'est installé autour des transes dans le champ thérapeutique en Occident, que j'accepte complètement, puisqu’il fait référence aux deux facettes de mon approche dont j’ai déjà parlé. La transe est à l'hôpital – je pratique l’hypnose au CHU de Bordeaux – mais elle est acceptée sous couvert d’être considérée en tant que thérapeutique comme une autre. On décide que l'hypnose peut être évaluée avec du test-retest, comme on le ferait avec un médicament, on peut prescrire des séances d'auto-hypnose, on peut prescrire de la méditation, etc. On n'exploite pas donc pleinement ce que sont les transes et ce qu'elles peuvent proposer, qui est cette bascule, cette embrouille au niveau sensoriel pour que l'individu arrive à se redéfinir. C'est ce que proposent les psychédéliques, et c'est pour ça aussi qu'il y a tant de réticences à leur sujet, alors qu'on a quand même beaucoup de recul là-dessus, ne serait-ce qu'avec les études des années 50-70 et depuis. Si les psychédéliques font peur, c'est que ces substances sont considérées comme une transe sauvage, non domestiquée. L'hypnose et la méditation de pleine conscience, ou mindfulness, vont être facilement acceptées parce qu'on a l'impression d’une transe domestiquée. On sait à peu près dans quel cas on peut les adopter et on peut les évaluer d’une certaine manière. Mais ça veut dire aussi qu'on les appauvrit, on fait comme si c'était une thérapie dite non-médicamenteuse. Or, dans le non-médicamenteux, il y a le terme médicament, qui reste la référence absolue. À partir du moment où il reste cette référence par rapport au médicament, on a l'impression qu'on arrive à dompter et probablement qu'on ne va pas aussi loin qu'on pourrait aller. Par exemple, les pratiques que l'on a de l'hypnose à l'hôpital sont des pratiques qui ne sont plus du tout celles du début du XXe siècle, qui étaient des pratiques de transe très directes, dans l'accompagnement de la personne pied à pied, avec des manifestations beaucoup plus exaltées. Et puis entre-temps, on a eu la PNL, on a eu la relaxation, on a eu la sophrologie, et on est actuellement à l’hôpital dans une pratique de transe qui est très édulcorée. C'est un peu plus que de la relaxation, mais on s’arrête là, alors qu’en étant à l’hôpital, on pourrait vraiment pousser le curseur beaucoup plus loin : l'interdisciplinaire est immédiatement à portée de main dans les bureaux à côté, ce qui permet un accompagnement très qualitatif, le contexte permettrait d'y aller extrêmement directement. C’est ça le jeu de dupe : on ne peut pas vraiment jouer la carte de cette embrouille de sens, aller déloger la personne de son sens commun pour travailler à partir de ça. Et ça va donner des suivis plus longs.
– Et qu'est-ce qu'il faudrait selon vous pour que ça évolue ? C'est une question de mentalité ou c'est une question de formation ?
– Je pense qu'il nous manque plein de petites choses. Je constate ce système en place, mais je ne le critique pas forcément. Il faut respecter la culture, il faut la nourrir, mais ne pas penser que la culture de l'autre est forcément supérieure à la nôtre ; on peut bien sûr s'en inspirer pour pouvoir faire avancer la nôtre. Cette forme de prudence est au service des patients. Ce qui nous manque, c'est laisser plus de place aux expériences patients, parce qu'eux, effectivement, nous disent là où il faudrait aller ou quand ils aimeraient quelque chose de plus rapide, de plus direct. Et puis ils vont parfois le chercher ailleurs parce qu'ils ne le trouvent pas dans notre système de santé. Il faut entendre ça, et il faut faire confiance au cadre thérapeutique qui est le nôtre. Dans un grand hôpital qui accompagne les personnes sous psychédélique dans le cadre de psychothérapie augmentée, pas en France donc, la prise en charge est en train de se déliter : on donne la substance au patient, qui a une poire pour appeler si jamais il y a un problème, mais il n’y a plus le niveau d’accompagnement nécessaire. Il ne faut pas considérer que les transes, en particulier avec la prise d'un produit, sont la panacée et que cela suffit. Il faut aussi une rigueur dans l'accompagnement et la prise en charge. C’est le risque d’une radicalité dont je parlais en introduction, de considérer que c'est la transe qui fait tout, parfois réduite à un produit ou à une technique quand on parle d'hypnose. La transe, c'est un moyen, ce n'est pas un but. On ne peut pas éliminer l'humain de l'équation, y compris celui qui est le sujet de la transe puisqu'il reste toujours une part de soi maintenue dans l’expérience. C'est toujours le sujet qui pense, qui ressent. Si on prend six personnes en respiration holotropique, avec le même accompagnant, la même musique, le même niveau de respiration, d'hyperventilation, les six expériences resteront différentes. Quand on a compris ça, quand on n'est pas ébloui par la transe mais qu'on la perçoit vraiment comme quelque chose qui “permet de”, tous les possibles sont ouverts. Ça demande beaucoup de rigueur dans le cadre thérapeutique.
– Cela demanderait de redonner aux patients plus de pouvoir dans la relation thérapeutique pour justement les mettre à contribution dans le processus de soin et de guérison ?
– C'est totalement ça et il ne peut pas en être autrement. À partir du moment où on est dans une méthode expérientielle, quelle que soit la manière dont on amène la transe, on est dans l'expérientiel par définition, et c'est ce que va en dire la personne qui va être le substrat qui va permettre de travailler dans la direction que l'on souhaite. C’est absolument le patient qui doit être mis au centre, c’est un partenaire total, ce pourquoi ce mouvement des transes prend place en santé intégrative. C’est un mouvement qui appelle une révolution de la médecine pour ne pas la limiter à la régulation d'un trouble mais qui considère la santé comme une compétence à part entière, et pour lesquelles le médecin, l'infirmier, le psychologue, le kiné sont des intervenants possibles, et où le patient est l'ordonnateur de ce qu'il nomme santé pour lui-même et la façon dont il l'organise.
– C'est ce qui pourrait bloquer aujourd'hui, parce que la médecine occidentale ne veut pas voir la relation patient – entité thérapeutique de cette manière ?
– Oui, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre que la peur ? Chez tout le monde, la peur est la grande émotion qui guide le monde. Quand on essaie de travailler autre chose, notamment avec les transes, c'est quand même dans l'immense majorité des cas pour arriver à faire quelque chose de sa peur. L'instinct de survie et donc la peur, se sentir attaqué, c'est vraiment ce qui guide le monde actuel. La médecine, au sens générique, n'échappe pas à ça. On est dans un système pyramidal. C'est le médecin qui travaille avec son équipe, mais ce n'est pas l'équipe qui travaille, c'est le médecin et son équipe. Toutes les pratiques doivent passer par l'université, les pratiques médicales en particulier. Je suis le seul en France à avoir des DU qui soient dans les universités de sciences humaines, tous les autres sont dans les facultés de médecine.
À l'hôpital, où je pratique depuis 1999 – date depuis laquelle je pratique également l’hypnose, ce sont les patients qui font bouger les choses. Je me souviens de l’histoire d’une patiente qui venait de se faire opérer en orthopédie par un médecin anti pratiques complémentaires, anti hypnose, pour qui tout ça était de la poudre aux yeux, “la science du vent” comme il disait. Cette patiente faisait de la gestion de la douleur avec moi, pour les suites de son opération et une douleur chronique préexistante. Elle avait un appareillage externe sur la jambe, qu’on allait lui retirer et grâce à l’hypnose, on a pu le faire sans qu’elle bouge, qu’elle ait mal ou qu’elle se plaigne de quoi que ce soit. Le médecin était si étonné qu’il a demandé des explications, et à partir de ce moment-là, on a eu le droit de travailler en orthopédie. Des histoires comme celle-là, des expériences patients qui ont permis que les mentalités changent et qu'il y ait une avancée progressive des choses, j'en ai des dizaines et des dizaines.
– C'est vraiment magique d'entendre ce genre d'anecdotes ! À l'inverse, qu'est-ce que la science nous dit sur l'hypnose, qui valide la légitimité de cette pratique ?
– La science nous dit d'une part que ça existe, et là aussi c'est une étape qui est importante. C’est lié à l'imagerie cérébrale, où nous sommes encore à la préhistoire des IRM, des PET scans, qui montre ce qui se passe à un instant t : on vous dit un prénom qui est connoté affectivement, votre cerveau va réagir et on va l’observer. L'imagerie ne prouve rien de plus que : la personne est vivante, il se passe des trucs dans son cerveau. C'était important que des personnes comme Pierre Rainville, Marie-Elisabeth Faymonville, montrent dans les années 90 qu'effectivement il y a une activation cérébrale non pas spécifique de l'hypnose, mais typique de l'hypnose. On ne connaît pas encore aujourd’hui tous les mécanismes, mais globalement à 70-80%, on retrouve toujours la même activation du cerveau et on peut dire que c'est un effet d'apprentissage. C'est vraiment un élément important. L'hypnose est généralement présentée comme une méthode antalgique, mais quelle que soit la méthode de transe, être dans un état de conscience non ordinaire, réduit de 25 à 30% de la douleur sans aucune suggestion. La science nous a appris que l'hypnose n'est pas spécifique à des objectifs en rapport à l'anxiété et à la douleur, mais que c'est un état d'apprentissage. Le cerveau est à la fois en train de se détendre et hyper-attentif. Le mode par défaut du cerveau, qui définit votre “je”, votre identité, va passer au deuxième plan. Les embrouilles sensorielles que l'on va organiser par telle modalité de transe ne sont pas qu'un jeu, elles sont une décomposition sensorielle, les pièces d’un puzzle qu'on remet à plat sur la table qu’on peut recomposer. Ce sont les mêmes pièces, le même nombre de pièces, parce qu’elles sont “moi”, et l'expérience me montre que je peux les agencer tout à fait autrement, et apprendre de ce que je suis en train de faire. L'individu se recompose au travers de son vécu, il est en train d'installer quelque chose de nouveau, ce n'est pas quelque chose que l'on reprogramme, c'est une expérience qui transforme.
– Donc la science de la transe et la diversité des contextes dans lesquels la transe arrive, ces deux parties sont au cœur du DU et du DESU que vous avez créé ?
– Oui. La volonté première était de construire un lieu dans lequel il y a à la fois des chercheurs et des praticiens, des expérimentalistes et des cliniciens, où il y ait des gens des sciences humaines, des sciences de la vie, etc. C'est d'organiser ce carrefour-là. Le livre est venu dans la lignée parce qu’on nous demandait régulièrement “Quel livre pouvez-vous nous conseiller ?”, et il n'y avait pas de livre. Il y avait des livres d’anthropologie, de neurosciences, mais pas de livre carrefour. Je voulais un livre académique, grosse brique, totalement assumé pour dire “C'est un fait scientifique, arrêtons de penser qu'il n'y a que de la poésie et de la folie là-dedans, c’est un carrefour entre les sciences et les pratiques, les gens ont raison de s'y intéresser”. Avec le tome 2, on va passer sur les modalités de pratique.
On met en exergue qu'il y a des spécificités qui peuvent être présentes, mais majoritairement il y a un schéma général qui se construit. Il peut y avoir des transes spontanées, mais quand on parle de transes provoquées, on va toujours tomber sur les mêmes modes d'induction. La façon d'accompagner comportera toujours les mêmes grandes dimensions. En fait, il n'y a que 12 ingrédients qui caractérisent les pratiques, mais qui permettent de caractériser des centaines de pratiques. L'idée était aussi d’avoir un lieu pour pouvoir discuter de tout ça, pour que même lorsque l'on parle d'une hypnose très expérimentale ou bien des pratiques chamaniques au fond de l'Amazonie, les deux intervenants peuvent être là et vont parler de choses communes pour partie. Ils vont parler de phénomènes transversaux. Les participants du DU sont souvent déboussolés par ça : ils se retrouvent avec un chercheur en neurosciences, avec moi qui leur parle de psychologie, avec Sébastien Baud qui va leur parler d’anthropologie. Ils ont l'impression d'être une boule de flipper, mais c'est voulu. J'assume de les mettre dans une embrouille, et tout finit par prendre sens pour eux, en fonction de qui ils sont et de leur parcours. Mon grand plaisir, ma jouissance, est qu’on me dise dans les derniers mois “On est allé dans des endroits auxquels on n'aurait pas pensé, et je ressors différent de ce que j'ai vécu avant.” Comme je m'adresse à des gens qui ont déjà des pratiques, soit personnelles et/ ou professionnelles, ils finissent aussi par faire le lien avec leur expérience.
– C'est un parcours initiatique ?
– J'essaie de le vouloir comme ça ! À la fac, quand même, c'est un comble…
– Ce que je retiens surtout, c'est la volonté d'ouverture vers un maximum de choses. Vous disiez tout à l'heure que c'est un DU en sciences humaines et pas en sciences médicales. À qui ça s'adresse aujourd'hui ? Et est-ce que, dans les années qui viennent, il y a une volonté d'ouvrir encore plus les publics accueillis ?
– Je dirais ouvrir et resserrer. Au début, c'était ouvert aux professionnels de santé, psychothérapeutes, ou à des personnes qui n'avaient pas forcément le titre ADELI mais qui avaient une pratique constituée, fiable... Et puis, avec le temps, des individus auxquels je ne m'attendais pas du tout sont venus à moi par le biais de cet enseignement. Je pense en particulier aux chorégraphes – les sculpteurs et les plasticiens je m'y attendais – à ceux venant du chant, de la danse, mais aussi du sport… Au-delà du flow, que l'on connaît tous, il y a d'autres pratiques, d'autres états qui vont être ressentis. Il y a eu toute une population que je n'avais pas du tout imaginée et pour qui les enseignements n'étaient pas pensés. Dans la nouvelle mouture que je suis en train de faire, il y a à la fois un élargissement vers les professionnels qui n'ont pas à être dans le champ du thérapeutique ou de l'accompagnement, et un resserrement, parce que malgré tout, ce n'est pas un enseignement juste pour les curieux. Les intervenants sont tellement passionnés qu’ils font en trois heures ce qu'ils feraient en dix par ailleurs. C'est un enseignement qui n'est pas du tout anonyme, pour lequel il faut avoir quand même un certain nombre de prérequis, et il faut qu'il y ait une intention professionnelle derrière.
– Si j'ai bien compris, l'année qui vient de s'écouler, vous étiez en train de refondre...
– C’est en jachère cette année, oui.
– D'accord. Et a priori, en novembre, ça va reprendre ?
– Probablement début 2026, parce que c’est une refonte que je fais avec d'autres universités, notamment internationales. Il y a la volonté de ne plus être le seul porteur de ce DU, et de l'ouvrir pour aller au-delà de mes limites, au-delà du champ strict de mes connaissances.
– On va passer à quelques questions de notre communauté qui semble ravie de la qualité de l'échange, de la profondeur de l'échange. Il y avait une question sur la transmission de savoir des expériences subjectives et intimes. Comment on aborde cet équilibre entre science et expérience dans l'enseignement ?
– N'importe qui vivant une expérience peut bien sûr poser des mots sur l'expérience, parfois des dessins, mais il y a quand même un art de l'entretien. C'est une façon d'aider les personnes à structurer leur discours, après. Ce n’est pas juste “Ah, ça a été agréable, je me suis senti partir, j'ai connecté telle ou telle chose.” On peut aller dans le corps, qu'est-ce qui s'est passé à tel moment, qu'est-ce qui a été présent, les associations d'idées, etc. Dans le but d'avoir une expérience très riche, très précise, très pointue, qui va être l'objet de la transmission. C'est un travail à partir de l'expérience de l'autre. Et c'est à partir de ces recherches que les choses sont retranscrites dans les enseignements. On va s'appuyer sur ces éléments qui seront ensuite publiés dans des supports scientifiques pour pouvoir dire “Il y a telle hypothèse, telle personne qui a soulevé ça, une personne qui a éprouvé ça, qui nous a permis de penser ça, etc.” La base de tout, c'est l'art de l'entretien, pour qu'au-delà de leur récit immédiat, on ait un récit typique de ce qui a été présent.
J'ai fait l'expérience d’un vol en apesanteur, il y a quelques années, où j'ai vécu un moment de transe quasi extatique. Je m'attendais à mener une recherche sur la conscience corporelle en apesanteur, avec l'Agence Spatiale Française et j'avais demandé à un collègue chercheur, Alfonso Santarpia, avec deux de mes doctorants, de me débriefer de façon extrêmement structurée, juste après l’expérience, et un mois après. Et j'ai pu me rendre compte, en tant que participant, à quel point cette façon de mener les entretiens était nécessaire. J'avais un enregistreur avec moi et j'ai pu consigner directement ce que j'avais ressenti à quel moment. Ensuite, Alfonso m'a débriefé avec une structure dont on avait convenu, avec des éléments précis apportés par la science. Il m'a demandé de produire un discours sur la base de nos critères, même chose un mois après, et ensuite nous avons tout analysé avec les doctorants. Le discours produit avec cette méthode n'avait pas grand-chose à voir avec mon rendu immédiat. C'est important aussi pour moi de pouvoir éprouver ces façons-là de travailler.
– Très intéressant l'art de l'entretien… Autre question de la communauté : Quels conseils donneriez-vous à une personne curieuse de s'engager sur ce chemin de recherche ou de pratique ?
– Je dirais que le seul conseil, à mon sens, qui serait utile, c'est qu'il ne faut pas se mentir sur la raison pour laquelle on le fait. Si on ne va pas très bien, on est un peu déprimé, il ne faut pas juste se dire “Tiens, je vais essayer de vivre une transe pour voir ce que c'est.” Il ne faut pas non plus s'aveugler sur “Est-ce que j'ai envie de gagner en spiritualité ? Est-ce que j'ai envie de connecter des mondes auxquels je n'ai pas accès ? Est-ce que je suis vraiment ouvert à l'expérience pleine et entière, telle qu'elle peut être présente, etc.” Ne pas se mentir sur la raison pour laquelle on souhaite le faire, parce que ça va orienter les pratiques ou avec qui on va le faire.
Ensuite, il y a deux types de pratique : non-psychédélique et psychédélique. Je fais cette distinction car même s’il y a une diminution du niveau de la volonté, l'apparition de mouvements automatiques pendant les transes, lorsque l'individu veut dire stop, il peut en sortir à n'importe quel moment dans une pratique non-psychédélique. Même si je suis dans un groupe de respiration holotropique, même si je suis accompagné au tambour, même si je suis en séance d'hypnose en groupe ou individuelle, si je décide d'arrêter, je peux arrêter facilement. Dans une expérience psychédélique, l’expérience va durer le temps que la molécule est dans le sang. Il faut veiller à cette dimension et sans doute que le premier réflexe n'est pas de partir au Pérou pour aller prendre je ne sais quoi, ou de se rendre dans une clinique à l'étranger.
– Merci pour cet entretien extrêmement riche. Pour moi, vous êtes un formateur d'explorateurs de la conscience. Ce que j'ai retenu, c'est la dimension sociétale, qu'on ne voit pas forcément au premier abord. J'aimerais peut-être finir là-dessus, parce que c'est quelque chose d'important et qui est délicat à percevoir.
– Merci pour votre retour. Pour moi elle est absolument essentielle : on est dans un monde qui est en train de bouger beaucoup et c'est important de repérer ces phénomènes présents. Le fait d'avoir des codes permet de pouvoir penser la société que l'on veut demain, quelles valeurs je souhaite porter, qu'est-ce que je vais promouvoir... Ça permet aussi de comprendre les phénomènes de liesse populaire, les retours du nationalisme dont je parlais tout à l'heure. Ce n'est pas que sécuritaire. Il y a autre chose. On voit bien dans l'attitude des individus combien il y a quelque chose qui est en train de les bouger. Et il n'y a pas les bons d'un côté, les méchants de l'autre. Il peut y avoir des radicalités dans tous les domaines, et se dire “Qu'est-ce que je construis et qu'est-ce que je veux porter ?”, c'est une dimension absolument fondamentale pour survivre au monde qui est en train d'être construit. Parce que c'est un monde qui est violent, qui se construit de façon extrêmement pénible. C’est pour ça que je parlais aussi des chorégraphes, des arts qui est le sujet du colloque dans un mois : la transe est aussi portée par l'art. Et je crois que l'art peut être la solution à ce qui est en train de se produire sociétalement. C'est comme une sorte de contre-feu. Ce qu'a fait David Dupuis notamment avec la dimension artistique en lien avec les productions sous ayahuasca exposées au Quai Branly l’année dernière. Je crois beaucoup à l'art et à la culture comme moyen de façonner ces transes qui, dans d'autres domaines, notamment politique, sont vraiment trop sauvages pour pouvoir produire quelque chose de cohérent.
– Merci beaucoup pour cet échange riche et inspirant. Vous avez une manière unique de relier la science, l’expérience et la société.
– Merci à vous. J’ai pris beaucoup de plaisir à cet échange. C’est toujours un bonheur de pouvoir partager et réfléchir ensemble.
Entretien enregistré via Zoom le 10 février 2025, en petit comité, et mené par Alexis et Clément pour l'INEXCO. La retranscription a été légèrement éditée par souci de clarté, sans changer les propos des intervenants.